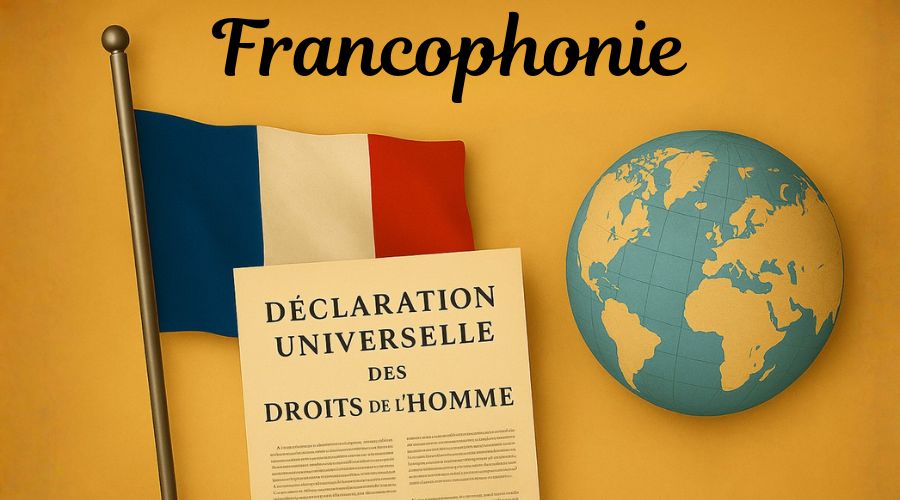La géopolitique du sport pour tous, les États !

Article paru sur La Tribune le 29 juillet 2025
L’été est une saison très favorable à la pratique sportive. La coupe du monde des clubs de football vient de nous faire vivre, et rêver. Le sport fédérateur, image d’un club ou d’une nation, et agent du soft power des États, a été jusqu’à présent l’apanage des grandes nations, ou des nations riches. Mais la diversité sportive, la diffusion mondiale télévisuelle, donnent à des États de plus faibles populations, et où qu’ils soient sur le globe, la possibilité de rayonner, et donc d’améliorer leur notoriété, leur image, et leur activité économique. Par Gérard Vespierre (*) analyste géopolitique.
La rencontre contemporaine du sport et de la géopolitique s’est concrétisée à la fin du XIXème siècle avec la 1ère édition des Jeux olympiques de l’ère moderne, à Paris, en 1896…. La nationalité du rénovateur, Pierre de Coubertin, et le rayonnement politique et économique français, ont permis à la France et à sa capitale d’occuper cette historique et prestigieuse position. Face à un État, une organisation créée deux années plus tôt, en 1894, avait permis d’élaborer et de développer le projet.
Dès lors ce processus très simple, à savoir la rencontre d’un pays et d’une organisation sportive internationale, ’allait plus s’arrêter, et même se démultiplier
La géopolitique olympique
Le CIO, a développé sur pratiquement un siècle, la diversification des participants et des publics. Après les Jeux Olympiques d’Hiver, créés en 1924, ont été préparés les Paralympiques. En parallèle, s’est mise en place la diversification des choix stratégique des sites à travers la diversité des continents d’accueil. La révolution télévisuelle depuis les années ’60 par les satellites de télécommunication, a permis d’atteindre plusieurs milliards de spectateurs.
Du point de vue des États, entrer dans la compétition des sites d’accueil, implique de s’immiscer dans le jeu du soft power, et d’accepter un haut niveau d’engagement financier. Le ticket d’entrée olympique se situe autour de 10 milliards de dollars. Pour organiser des événements sportifs mondiaux il faut avoir une vraie capacité diplomatique. Il faut faire partie d’un cénacle restreint et comprendre comment fonctionnent la diplomatie, les relations internationales, leurs usages et le rapport aux autres États, afin de faire valoir ses positions et objectifs.
La géopolitique du sport exprime la mondialisation mais aussi l’universalisme, c’est-à-dire, réunir tous et impliquer chacun.
Les sports d’équipe, football, rugby, basket-ball, reprennent dans l’imaginaire populaire les affrontements militaires des nations. « Le sport c’est la guerre, les fusils en moins » selon la formule créée par George Orwell, en 1945. Dans la guerre, il y a aussi ce que l’on a appelé « l’arrière » les citoyens. Aujourd’hui dans le sport, on trouve la population des fans, des supporters. Les épreuves individuelles, tennis, athlétisme, natation, recréent des héros.
Qu’est-ce qui permet aujourd’hui à une population de se sentir concernée en tant que nation ? Les grands événements sportifs constituent une opportunité pour une population de se sentir regroupée dans ce concept.
La puissance médiatique démultipliée par le relai des réseaux sociaux, crée désormais une caisse de résonnance à cette émotion collective. Lors de la Coupe du Monde de football, c’est la moitié de l’humanité qui est touchée. Les Jeux, c’est plus de 3 milliards et demi de personnes
La géopolitique des Fédérations, et ligues… nationales
Face à la toute-puissance du CIO, les fédérations sportives mondiales ont suivi un chemin parallèle, de développement géographique et de diversification. La Coupe du Monde des Clubs de football qui vient de se dérouler, est organisée par la Fédération internationale de football association (FIFA). Cette compétition créée en 2000, vient cette année de vivre une nouvelle formule élargie à 32 clubs. Plus d’équipes, plus de pays impliqués, plus de téléspectateurs, plus de budget de la part des diffuseurs. Un budget annuel de 2 à 4 milliards de dollars, avec le maximum lors de l’année de la Coupe du Monde, donne une idée de la capacité d’action géopolitique d’une fédération internationale, de sa puissance de développement, et de communication.
Mais ces structures à responsabilité mondiale, ne sont plus les seules à pouvoir intervenir sur la scène sportive. Il convient de prendre en compte la puissance financière et de rayonnement de structures, au départ nationales, mais qui par la taille de leur marché intérieur et de la force d’attraction de leurs vedettes, sortent de leur périmètre géographique.
L’exemple de la National Basket Association américaine (NBA) est tout-à-fait révélateur. Forte d’un budget annuel de 11-13 milliards de dollars, avec une part des droits de télévision dans la zone des 50%, elle est à même, depuis le territoire des États-Unis, de développer une stratégie de mondialisation. En 2025 elle organisera des rencontres du championnat américain, dans 5 pays : Mexique, Émirats arabes unis, France, Australie, et Chine. Marchés stratégiques pour le développement de son sport, le basketball, elle y réunit des millions de fans américains.
La NBA a déjà organisé plus de 200 matchs internationaux depuis 1978. Ainsi est en train de naître un nouvel acteur géopolitique du sport mondial à partir de racines nationales. La diversité de puissants acteurs est ainsi en train de s’étendre. Mais il faut aussi intégrer un axe géographique.
L’émergence Africaine
Les événements sportifs internationaux, et mondiaux, constituent des vecteurs de croissance, des instruments de prestige, une vitrine touristique. Les objectifs possibles sont donc nombreux, mais ils traduisent la même volonté d’accroissement de puissance, du Maroc au Kenya en passant par le Sénégal, la Côte d’Ivoire, ou l’Éthiopie. Le Maroc prépare la construction du plus grand stade du monde (115 000 places) dans la perspective de la co-organisation de la Coupe du monde de football en 2030 (avec l’Espagne et le Portugal) et le Sénégal prépare les JO de la jeunesse en 2026.
La plupart des pays prometteurs du continent sont particulièrement actifs dans le secteur sportif.
Il émerge donc ici une stratégie intégrée et pensée en amont dans laquelle le sport fait figure de produit d’appel pour l’image de marque nationale.
Pointe ici les notions de nation branding, et de sport power, déclinaisons du soft power des États.
Stimuler le développement national par le tourisme et véhiculer une image de prestige à l’étranger, tels sont les grands objectifs géopolitiques des pays africains. À terme, l’enjeu est également de peser dans l’organisation mondiale du sport.
Les limites d’infrastructure et de capacité économique ne doivent pas cacher l’intérêt de l’Afrique pour le sport mondial. Sa présence de plus en plus évidente.
De nouveaux critères, faible population et éloignement géographique
Mais les choix par les organisateurs d’événements, de pays d’un haut niveau de population, et placés dans les zones de grande activité économique, ne sont plus des nécessités grâce à la miniaturisation des moyens de prise de vue et les capacités de diffusion satellitaire.
L’émergence de sports nouveaux, et de pratique avec un effectif réduit de sports existants, comme le rugby à 7, l’ouverture vers de nouvelles surfaces, la plage, avec le Beach volley, et le Beach soccer, représentent de nouvelles opportunités de visibilité et de médiatisation.
L’exemple des Seychelles, qui ont organisé la Coupe du monde de Beach Soccer (FIFA) en mai dernier, est tout-à-fait révélateur de ces nouvelles opportunités autour d’un sport naissant, pour un pays de 120.000 habitants, répartis sur un archipel de 115 îles, au milieu de l’Océan Indien ! Dans la géopolitique mondiale du sport au XXIème siècle, tout est devenu possible. Les Seychelles ont osé.
Le Rwanda a accueilli en décembre 2024, à Kigali, l’Assemblée générale de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), où s’est déroulée la cérémonie annuelle de remise des prix du championnat du monde. On a pu y voir Max Verstappen, quatre fois champion du monde de F1. Le Rwanda recevra également au mois de septembre les participants au Championnat du monde de cyclisme sur route (UCI). Deux événements mondiaux et mondialisés, en moins d’un an, pour un pays de 16 millions d’habitants. . Cette stratégie sportive a débuté en 2021, avec l’accueil des phases finales de la Basketball Africa League (BAL), en partenariat avec la NBA (!). Cette collaboration se poursuit depuis lors, et positionne le pays au niveau continental. Le Rwanda a même lancé un audacieux sponsoring de clubs majeurs comme Arsenal, le PSG, le Bayern Munich ou l’Atlético de Madrid, avec la campagne Visit Rwanda, s’exposant ainsi sur les plus grands stades européens.
Il est fort possible que le Rwanda ne s’arrête pas là, puisqu’il ambition d’organiser le premier Grand Prix d’Afrique de Formule 1.
L’organisation d’événements mondiaux atteste de la maturité logistique d’un pays, de ses capacités événementielles et touristiques, également au service de ses propres habitants. L’importance de la population nationale n’est désormais plus un critère. La volonté politique y trouve pleinement sa place.
La géopolitique du sport, à l’image de la géopolitique elle-même, doit s’inscrire dans le temps long. Il faut prévoir et organiser la durée. Il est donc impératif pour tout pays qui choisit de s’engager dans le sport power, d’être conscient dès le début, qu’il sera déterminant pour lui de conforter cette stratégie dans le temps. Seuls les nouveaux acteurs qui en auront pris conscience, et développé un plan de long terme, verront leurs investissements dans la géopolitique du sport, valorisés et confortés dans le temps.