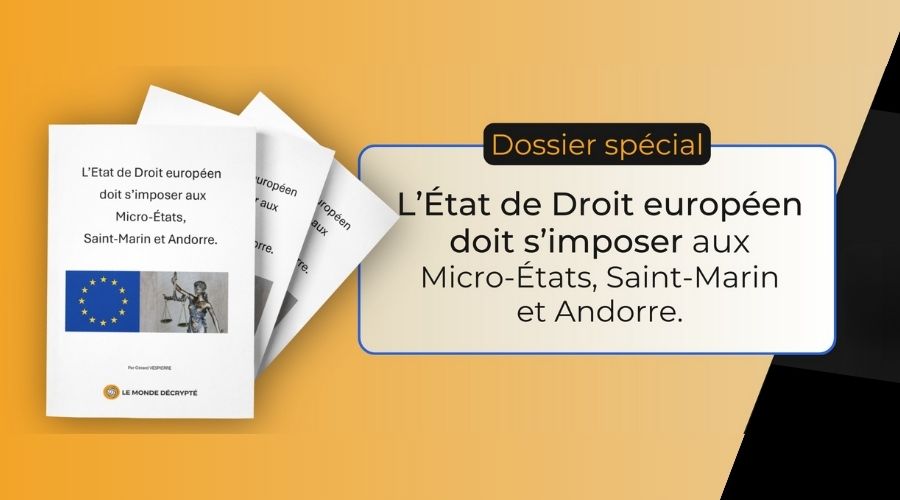La Francophonie, a-t-elle toute sa place dans la géopolitique française ?
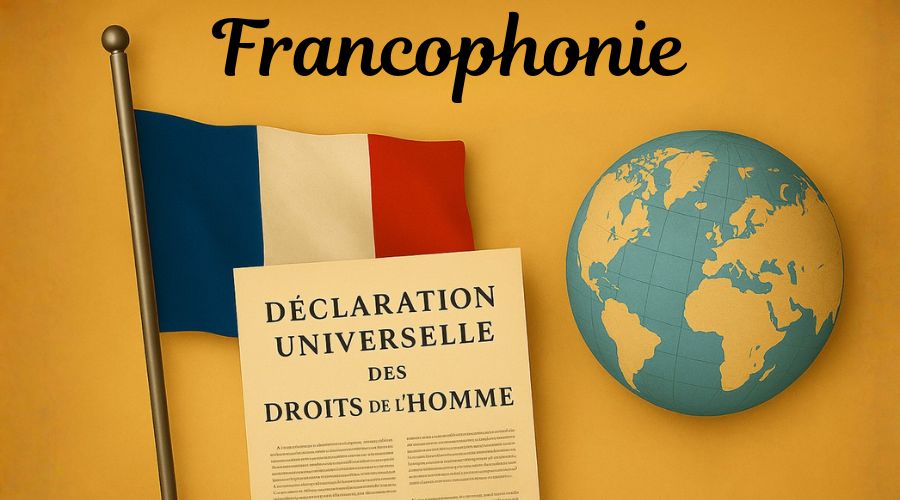
Par Gérard Vespierre*
La francophonie s’inscrit dans l’action extérieure de la France. Elle s’est concrétisée, et structurée, avec la création de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en 1970. Elle est la seule organisation au monde, orientée vers le rayonnement d’une langue et d’une culture, et regroupant autant d’États. Elle est née de l’évolution de la situation géopolitique de la France après la période de décolonisation. Elle s’exprime dans de nombreux domaines culturels, la communication, et naturellement l’enseignement. Mais ne pourrait-elle pas s’impliquer dans d’autres domaines, grandir encore, et s’épanouir davantage ?
À titre indicatif, deux prérequis sont nécessaires pour obtenir le statut le moins contraignant, à l’OIF celui d’observateur : « se fonder sur une volonté de favoriser le développement de l‘usage du français, quel que soit son usage effectif au moment de la demande » et « un intérêt réel pour les valeurs défendues par la Francophonie, et ses programmes ». S’il se pose la question de la solidité d’une communauté francophone, sur ces bases, ils permettent néanmoins d’ouvrir la porte de l’Organisation à des pays reconnaissant la qualité de l’apport de la France à la communauté mondiale à travers sa culture, ses valeurs et apports juridiques, accroissant ainsi le rayonnement de l’Organisation, et de la Francophonie.
Un incontestable potentiel
En 2025, on estime qu’il y a environ 348 millions de francophones dans le monde. Ce chiffre inclut les personnes qui parlent le français comme langue maternelle, seconde langue ou langue étrangère.
Le français est langue officielle ou co-officielle dans 29 pays souverains à travers le monde. Si l’on inclut également certains territoires non souverains (comme le Québec au Canada ou la Wallonie en Belgique), ce nombre peut s’élever à environ 47 entités où le français a un statut officiel.
Le Français est la 5ème langue des publications sur l’internet. On aurait pu s’attendre à un classement légèrement plus favorable, mais Il faut tenir compte de la relative faiblesse de la population nationale, la France se classant au…. 22ème rang mondial. En 2022, on comptait 144 millions d’apprenants du et en français dans le monde.
A travers ces chiffres, on constate la réalité d’un univers linguistique et culturel francophone, dépassant les presque 69 millions de citoyens français. La France est donc totalement fondée d’avoir créé, avec la contribution de pays partenaires, une institution regroupant cette fraternité culturelle. L’OIF est maintenant forte de 88 États et gouvernements, sous les statuts de Membre, Membre associé, et observateur.
Les projections démographiques des prochaines décennies indiquent que la population francophone s’accroîtra de façon significative. Il est pratiquement certain que le chiffre de 600 millions de francophones sera atteint et dépassé au cours du XXIème siècle. Il faut naturellement tenir compte des incertitudes liées au temps long, mais le niveau de telles perspectives imposen de réfléchir dès maintenant aux stratégies à mettre en place.
Les limites et difficultés
À la différence du Commonwealth of Nations, qui lie les anciens « joyaux » de l’Empire britannique à la Grande-Bretagne depuis 1926 (ou 1949 dans sa forme actuelle), la dimension économique n’a jamais été au centre du projet francophone. La France oublie que les dynamiques de ses expansions culturelles vers d’autres continents, résultent en réalité d’une démarche initiale, commerçante. Rendons hommage à la Compagnie des Indes….
A cette limite conceptuelle, s’ajoute les inhérentes difficultés de la vie d’une organisation internationale avec une majeure africaine. L’absence d’une anticipation et d’une évolution de la politique française en Afrique a conduit à des désaccords profonds, alimentés d’ailleurs par des puissances non amicales…
L’année 2025 a vu la sortie de trois pays du Sahel (Mali, Niger, Burkina-Faso) de l’OIF en réaction à leur suspension de l’organisation. Cet épisode a relancé le débat sur tous les aspects les plus flous de l’action de la francophonie : son rôle politique, mais aussi la place que la France devrait y tenir. Mais n’oublions pas que les raisons de ces départs relèvent de situations politiques s’inscrivant plus dans le court et moyen terme que dans le long terme, qui s’appuie sur les incontournables de l’Histoire et de la culture.
Par ailleurs, la France est confrontée à une baisse d’influence dans d’autres parties du monde, au Proche et Moyen-Orient, face à la poussée économique, politique et sécuritaire, anglo-saxonne.
La séduction et la francophilie et nouvelles thématiques
Si l’OIF rassemble 88 États et gouvernements, c’est qu’elle a séduit un grand nombre de pays au-delà du lien linguistique. L’histoire de notre pays, son patrimoine culturel, littéraire, continue d’exercer un attrait réel sur le monde. La France premier pays visité au monde, attire également par la beauté de ses paysages, sites et monuments. Les touristes reconnaissent également la qualité de sa gastronomie. Il y existe donc une capacité globale d’attraction de notre pays vis-à-vis de beaucoup de citoyens du globe.
En analysant l’historique récent de l’OIF on s’aperçoit qu’au regard des différents statuts possibles, membre, membre associe, observateur, les dernières arrivées sont respectivement de 2006, 2016, et 2018. De nouvelles adhésions sont donc à la fois nécessaires et leur recherche doit s’inspirer d’un cercle d’attraction plus large que la francophonie de base, c’est-à-dire la francophilie.
Peut-être faut-il même envisager de porter le regard, également sur d’autres thématiques de réflexion et de travail qui concerneraient bien d’avantage de pays, à savoir l’évolution du climat, la santé, l’éducation.
Sur ces trois dernières thématiques, pourrait alors se dégager l’orientation souhaitée par l’OIF, deuxième organisme de représentation mondiale derrière l’ONU. En représentant plus de pays, regroupés autour d’un cercle commun de valeurs, et de culture, une OIF plus large et plus forte pourrait faire entendre leurs demandes, dans un cadre de préoccupations planétaires, climat, santé, éducation.
Le sens de la présidence Rwandaise
Les personnalités en charge de diriger l’OIF ont toujours joué un rôle certain sur la scène internationale. En tant que Secrétaire Général de l’organisation, elles occupent une responsabilité d’un rang comparable à celui du Secrétaire général de l’ONU ou du directeur général de l’UNESCO.
L’actuelle titulaire du poste, Louise Mushikiwabo, est en fonction depuis le 1er janvier 2019. Ministre rwandaise de l’Information (2008–2009) elle a débuté sa carrière politique en tant que porte-parole du gouvernement.
Elle devint ensuite ministre des Affaires étrangères et de la Coopération (2009–2018) et donc, voix du Rwanda sur la scène internationale, pendant près de dix ans. Elle est la première femme africaine à diriger l’OIF, et par ce cursus elle possède pleinement les qualités de communication et de représentation internationale dont l’OIF a besoin.
La présidence rwandaise a provoqué des débats. Pourquoi un pays anglophone obtient-il de la présidence de l’OIF ? Le Rwanda, membre actif de la Francophonie depuis 1970, a toujours valorisé le français dans son administration, son éducation et sa culture, tout en adoptant le plurilinguisme. Il a maintenu l’enseignement du français malgré l’élargissement de ses horizons vers la langue anglaise et le Commonwealth. Pour Kigali, la diversité linguistique est une force, non une contradiction. Le pays veut s’affirmer comme un acteur clé pour une Francophonie moderne. Sa direction actuelle de l’OIF est donc naturelle, et porteuse de sens vis-à-vis des orientations du futur.
Ce double choix, humain et politique, est dans la ligne de l’élargissement de la francophonie vers la francophilie, comme dans celle de faire rentrer des problématiques planétaires dans l’action de l’OIF.
Le prochain et 20ᵉ Sommet de la Francophonie se tiendra au dernier trimestre 2026, à Siem Reap, au Cambodge, à proximité des mythiques temples d’Angkor.
Ce sera la première fois que le Cambodge accueillera ce sommet, et seulement la deuxième fois qu’il se tiendra en Asie, après Hanoï en 1997. Cette première, et ce retour, participent à la montée en puissance des pays asiatiques, en dehors de la Chine, et de l’importance de l’Indopacifique. Puisse cette localisation être aussi l’expression d’une géopolitique nouvelle de la francophonie.
(*) Analyste géopolitique, diplômé de l’ISC Paris, Maîtrise de gestion, DEA finances Dauphine PSL, fondateur du Média web www.le-monde-decrypte.com chroniqueur IDFM 98.0